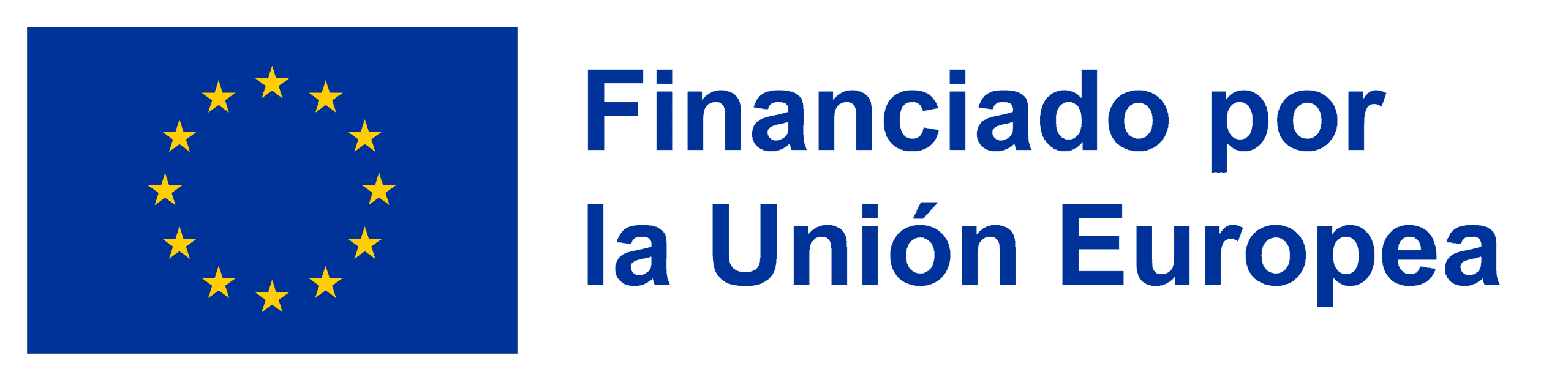Une nouvelle loi prévoit la déclassification de milliers de documents vieux de plus de 45 ans. L’occasion, peut-être, de lever enfin le voile sur les zones grises de la transition espagnole.
Photos : Equinox
La dictature franquiste n’est un secret pour personne… Ou presque. Depuis 50 ans et la chute du régime franquiste, certaines archives et leurs informations sont toujours fermées, hautement classifiées. Mais cette interdiction va changer.
Le Conseil des ministres a approuvé mardi 22 juillet un avant-projet de loi sur l’information classifiée, qui remplacera la loi franquiste sur les secrets officiels. L’une des grandes nouveautés du texte, par rapport à celui rédigé en 2022 (jamais arrivé jusqu’au Congrès), figure dans une disposition transitoire : elle prévoit la déclassification automatique de toute documentation secrète vieille de 45 ans ou plus à l’entrée en vigueur de la loi, sauf si l’on estime de manière « motivée et exceptionnelle » que la divulgation représente encore une menace pour la sécurité et la défense nationale.
Dans le meilleur des cas, la loi sera adoptée d’ici la fin de l’année, et s’appliquera fin 2026, puisqu’un délai d’un an de vacatio legis est prévu (période entre la publication de la loi et son application). Cela signifie que la déclassification massive concernera tous les documents antérieurs à 1982.
Ce serait une grande avancée pour l’Histoire de l’Espagne, qui baigne encore aujourd’hui dans les mystères du régime franquiste.
Concrètement, que peut-il y avoir dans ces dossiers ?
Les secrets officiels de l’Etat peuvent contenir bien des révélations. Les experts estiment que l’on ne trouvera pas d’information pouvant modifier complètement la perception du régime dictatorial de Franco, mais leur contenu pourrait éclairer plusieurs moments-clés de l’Histoire, jusque là encore flous.
Par exemple, le passage à la démocratie, amorcé à la mort du dictateur en 1975, a-t-il suivi un plan soigneusement orchestré ou s’est-il improvisé au fil des rapports de force ? On pense aussi à la légalisation du Parti communiste, en 1977, qui n’a jamais été pleinement expliquée : a-t-elle été négociée en coulisses ou imposée par la pression de la rue ?
L’ombre persiste également sur le 23 février 1981, date à laquelle des militaires ont tenté un coup d’État en prenant en otage le Parlement. Malgré des décennies de récits glorifiant le rôle du roi Juan Carlos, des doutes subsistent quant à son niveau de connaissance sur l’opération et sur les soutiens dont jouissaient les putschistes dans les hautes sphères militaires.
Lire aussi : 50 ans après sa mort, Franco divise encore l’Espagne (et les jeunes)
Plus tôt, en 1975, l’Espagne s’est retirée brutalement du Sahara occidental, dans le contexte de la « Marche verte », alors que Franco était agonisant. Cette décision géopolitique majeure reste absente des archives espagnoles : seuls des documents américains, récemment déclassifiés, révèlent l’ampleur des pressions diplomatiques exercées à l’époque.
Sur la question de Gibraltar aussi, le mystère demeure : entre la fermeture de la frontière en 1969 et sa réouverture en 1983, aucun document officiel espagnol n’a été rendu public. Les chercheurs doivent se contenter des archives britanniques, qui livrent une version unilatérale du différend.
Les relations tendues avec la France, elles, apparaissent en filigrane dans les années 1970, notamment sur la question basque : Paris tolérait alors la présence de militants du groupe terroriste ETA sur son sol, tout en se méfiant de l’entrée de l’Espagne dans la Communauté économique européenne.
À l’intérieur du pays, la violence a aussi marqué cette période supposément pacifique : en 1976, à Vitoria, la police a tiré sur des ouvriers grévistes retranchés dans une église, faisant cinq morts ; en 1978, les ferias de Pampelune ont été endeuillées par des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ; en 1979, un incendie criminel à l’hôtel Corona de Aragón, à Saragosse, a tué 83 personnes sans que les responsables ne soient identifiés. Sur tous ces points, les archives espagnoles se montrent silencieuses.
Quant aux relations avec les États-Unis, elles planent sur la fin du franquisme comme un secret bien gardé : le meurtre de l’amiral Carrero Blanco en 1973, bras droit du dictateur, l’accident nucléaire de Palomares en 1966 ou encore les accords militaires de 1953 pourraient être mieux compris si Madrid acceptait de lever le voile. Mais une nouvelle loi permet aux autorités de bloquer l’accès à tout document couvert par un accord international : un bouclier commode pour enterrer définitivement certains dossiers sensibles. La route vers la vérité est encore longue, et semée d’embûches.