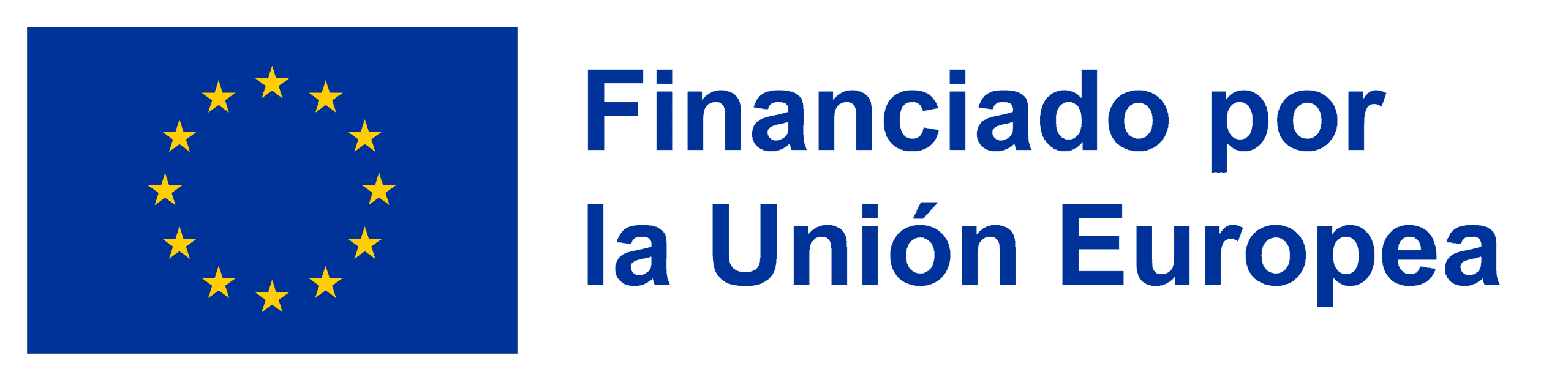Les immigrés latinos dopent l’économie espagnole, tandis que leur intégration dans la société locale semble facile et naturelle. Exemple à suivre ou effet d’optique ? Eléments de réponse.
Photos : Clémentine Laurent
A part son prénom typiquement américain, Matthew pourrait parfaitement passer pour un Catalan. Arrivé du Pérou alors qu’il n’avait que 7 ans, le jeune homme manie la langue de Verdaguer aussi bien que l’espagnol. « Je travaille dans les deux langues sans problème ». Ses parents sont arrivés à Barcelone en premier, au début des années 2000, et les ont fait venir, lui et son frère, un peu plus tard, le temps d’avoir tous les papiers. « Ils sont venus pour des raisons économiques, pour que nous ayons tous une meilleure vie ». Depuis, trois oncles et leur famille respective les ont rejoints. Seuls les grands-parents sont restés au pays. « C’est plus facile quand tu as déjà de la famille sur place, tu as un logement quand tu arrives, et des bons plans pour travailler aussi ».
Le cas de Matthew est loin d’être une exception. Les familles latino-américaines ont tendance à se regrouper dans les mêmes villes, recréant ainsi le cercle familial et profitant d’un réseau de solidarité très actif. Plus de 3,7 millions de latinos vivent actuellement en Espagne, la plupart ayant quitté leur pays en raison de crises économiques ou politiques.
Et ils continuent d’arriver, représentant aujourd’hui la moitié des nouveaux immigrés, loin devant les Européens (29 %) et les Africains (19 %), selon l’Institut national des statistiques. Les Colombiens dominent ce flux, suivis par les Vénézuéliens, les Équatoriens et les Argentins. Les communautés péruviennes et boliviennes occupent également une place significative.
Politique d’immigration ouverte
Et l’Espagne les accueille les bras ouverts. Avec une croissance de 3,2 % en 2024 et une prévision de 2,4 % pour 2025, le pays manque de bras. D’après l’institut Funcas, six créations de postes sur dix reviennent à des personnes nées à l’étranger et la moitié de la croissance repose directement sur l’apport de l’immigration. Madrid mène donc une politique d’immigration très ouverte, à contre-courant de ses voisins européens. Les migrants venus d’Amérique latine bénéficient d’ailleurs d’un atout majeur : grâce aux accords conclus entre l’Espagne et ses anciennes colonies, ils peuvent demander la nationalité après seulement deux ans de résidence.
« C’est nous qui portons la croissance du pays ! », s’exclame, en faisant mine de plaisanter, Daisy, elle aussi originaire du Pérou. Cette dynamique quinquagénaire, assistante à domicile, assure que ses concitoyens occupent les emplois dont ne veulent pas les Espagnols, et forment un bataillon indispensable au PIB local.
Et les chiffres lui donnent raison. Les Latino-américains aident à pallier les manques de main-d’œuvre dans des secteurs sous tension, notamment l’hôtellerie, mais aussi la construction, le commerce, les transports, la santé ainsi que les gardes de personnes âgées ou d’enfants. Le patronat milite d’ailleurs pour l’accélération des procédures administratives afin de faciliter les embauches.
Des salaires plus bas que les Espagnols
De fait, l’immigration latina s’est parfaitement fondue dans la société espagnole, passant presque inaperçue. Question de langue, de culture ou de religion ? Certainement, un peu de tout cela à la fois. En tous cas, elle n’alimente pas les discours enflammés de l’extrême droite, qui tire à boulet rouge sur les immigrés africains, ou ceux d’une certaine extrême gauche, qui, à moindre mesure, a fait des expats européens sa nouvelle tête de turc.
Intégration oui, mais égalité, pas tout à fait. « La proximité culturelle et la langue leur permet de trouver rapidement du travail, explique la sociologue Ana María López Sala, mais les perspectives d’évolution restent limitées et ils restent souvent dans des secteurs où les salaires sont bas ».
Selon les chiffres gouvernementaux, les travailleurs latino-américains touchent en moyenne 42 % de moins que les Espagnols, sans évolution notable en fonction de l’ancienneté, comme c’est le cas pour les locaux. Soit environ 1400 euros nets mensuels, tous âges confondus.
Et pourtant, beaucoup s’en contentent. « J’ai eu tellement de mal à avoir mes papiers », raconte Loli, trentenaire originaire du Honduras. Alors avoir un CDI qui lui permet de renouveler son permis de résidence, c’est déjà beaucoup. Même si c’est pour travailler très tard le soir pour le SMIC, et vivre dans une colocation avec sept personnes. « Au Honduras, il n’y a pas de travail, il n’y a rien que tu puisses faire pour t’en sortir, donc oui, les efforts ici valent la peine ». La jeune femme espère ensuite pouvoir faire venir son petit frère et ses parents. « Pour vraiment vivre ».