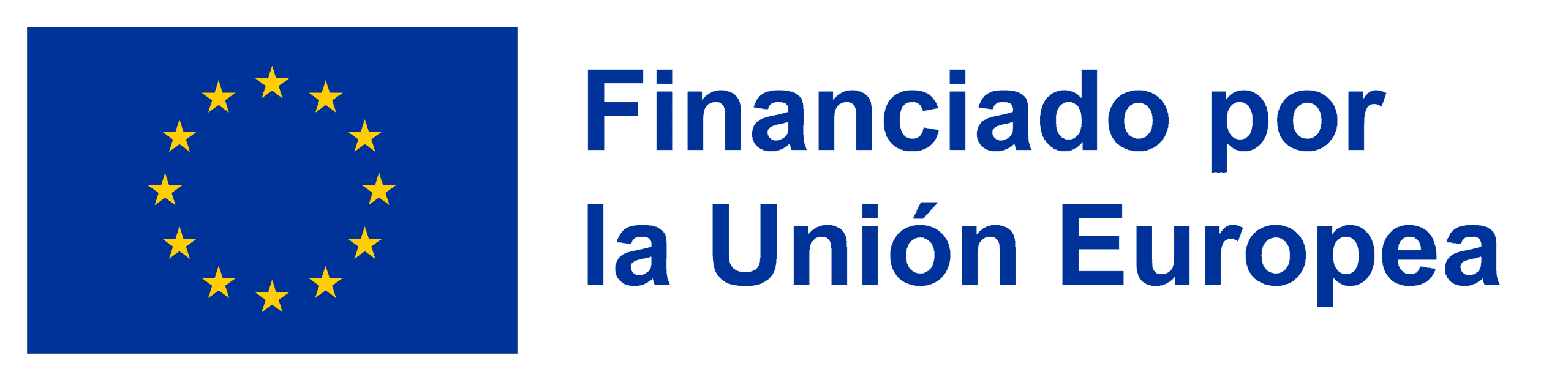Avec la réforme de 2025, chaque parent en Espagne bénéficie désormais de 19 semaines de congé rémunéré et non transférable après la naissance d’un enfant. En moins de vingt ans, le pays est passé de deux jours à l’un des systèmes les plus avancés d’Europe, plaçant la coresponsabilité parentale au cœur de sa politique sociale et économique.
Imaginez un saut dans le temps jusqu’à l’année 2015. Dans un appartement de la Rambla de Tarragone, un couple partage ses premiers jours avec son nouveau-né. Elle, ingénieure, dispose de 16 semaines de congé maternité. Lui, consultant, bénéficie de 13 jours de congé paternité, une amélioration notable par rapport aux deux jours ouvrables reconnus avant la promulgation de la Loi organique 3/2007 pour l’égalité effective entre femmes et hommes. Comme dans la majorité des foyers, la répartition des soins était inégale.
Huit ans plus tard, avec leur deuxième enfant, la scène fut différente. En 2023, tous deux profitèrent déjà de 16 semaines de congé rémunéré et non transférable. Ce changement ne fut pas soudain, mais le résultat de réformes successives ayant culminé avec le Décret-loi royal 6/2019, qui établit l’égalité complète des parents en 2021, y compris l’obligation de prendre les six premières semaines suivant la naissance ou l’adoption.
En juillet 2025, le gouvernement espagnol annonça l’approbation du Décret-loi royal 9/2025, qui étend le congé pour naissance et soins de l’enfant à 19 semaines rémunérées pour chaque parent. Parmi celles-ci, les six premières demeurent obligatoires, 11 peuvent être prises librement au cours des 12 premiers mois, et deux (quatre dans les familles monoparentales) peuvent être utilisées jusqu’aux 8 ans de l’enfant. Dans les familles monoparentales, la durée totale s’élève à 32 semaines et, en cas de naissance multiple ou d’enfants handicapés, deux semaines supplémentaires sont accordées par parent.
Ce congé coexiste avec le congé parental additionnel de huit semaines non rémunérées introduit par le Décret-loi royal 5/2023 à travers le nouvel article 48 bis du Statut des travailleurs. Ce droit, individuel et non transférable pour chaque parent, leur permet de suspendre leur contrat de travail pour s’occuper, de manière flexible, d’enfants de moins de huit ans.
Le RDL 5/2023 introduisit également le congé pour force majeure afin de couvrir les soins urgents, d’une durée de quatre jours rémunérés, mais laissa sans solution la question la plus importante : la rémunération exigée par la Directive européenne 2019/1158 pour le congé parental – qui n’est pas le même que le congé pour naissance et soins de l’enfant – permettant de s’absenter du travail pour s’occuper d’enfants de moins de huit ans.
La Commission européenne a averti l’Espagne de ce retard et, en 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a sanctionné l’État pour non-respect des délais de transposition. En conséquence, l’Espagne doit encore garantir le financement complet du congé parental afin de se conformer à la réglementation communautaire.
L’Espagne dans le contexte européen et international
Avec la réforme de 2025, l’Espagne se situe parmi les pays les plus avancés en matière de congé pour naissance et soins de l’enfant, lequel est rémunéré à 100 %, égalitaire et non transférable, avec des mesures spécifiques pour les familles monoparentales et en cas de handicap.
La Suède occupe la première place du classement européen avec un congé parental de 480 jours rémunérés par enfant, dont 390 jours payés à 80 % du salaire et les 90 restants à montant fixe. De plus, au moins 90 jours sont non transférables pour chaque parent, favorisant la coresponsabilité et plaçant le pays comme référence mondiale en matière de conciliation.
Aux États-Unis, il n’existe pas de congé parental rémunéré au niveau fédéral. Seules 12 semaines d’absence non payée sont garanties, applicables dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ces dernières années, plusieurs États – comme la Californie, New York ou le New Jersey – ont créé leurs propres programmes de congé parental rémunéré. Contrairement à l’Espagne, l’accès dépend de l’État, de l’entreprise et du contrat, générant de fortes inégalités.
Au-delà de la loi : usage réel et impact économique
Le cadre juridique espagnol ne garantit pas à lui seul un usage égalitaire entre parents. Selon le ministère de l’Égalité, plus de 90 % des mères utilisent l’intégralité de leur congé, contre 85 % des pères. La différence est faible, mais suffisante pour montrer que des barrières culturelles et professionnelles persistent.
Selon l’OCDE, de nombreux hommes pensent que prendre tout le congé pourrait freiner leur carrière, leur promotion ou leur salaire. Cette crainte coexiste avec des stéréotypes de genre qui continuent d’associer les soins aux mères, ainsi qu’avec l’absence d’une culture d’entreprise normalisant la figure du père aidant.
Les inégalités socioéconomiques influencent également l’usage des congés. Les femmes occupant des emplois précaires ou faiblement rémunérés rencontrent le plus de difficultés à en bénéficier. Le paradoxe est que celles qui en ont le plus besoin sont celles qui rencontrent le plus d’obstacles, une fracture de classe qui accentue le risque d’inégalité. La loi promeut la coresponsabilité, mais la pratique avance plus lentement.
À ces barrières individuelles s’ajoute le défi pour les entreprises. Les PME expriment notamment leurs inquiétudes concernant la réorganisation interne liée aux absences prolongées. Cependant, les données montrent une autre réalité : les entreprises qui mettent en œuvre des politiques solides de conciliation entre vie professionnelle et personnelle non seulement fidélisent mieux leurs talents, mais réduisent aussi significativement le taux de rotation du personnel.
À l’échelle mondiale, la contribution économique des femmes n’atteint toujours pas son plein potentiel, notamment parce qu’elles assument majoritairement le travail des soins. Les études internationales montrent que les congés parentaux égalitaires ne sont pas seulement une mesure de conciliation, mais aussi un pari économique.
Ces politiques favorisent la participation des femmes à l’emploi, redistribuent les soins et augmentent la productivité. Un rapport récent de l’OIT révèle une différence mondiale de plus de cinq mois entre la durée moyenne des congés parentaux rémunérés des femmes (24,7 semaines) et des hommes (2,2 semaines).
L’OIT estime par ailleurs que garantir des congés rémunérés d’au moins 14 semaines pour les deux parents nécessiterait un investissement équivalant à 0,13 % du PIB mondial, mais pourrait créer plus de quatre millions d’emplois formels d’ici 2035. En somme, l’égalité n’est pas seulement une question de justice sociale, c’est aussi un moteur de croissance économique.
Parmi les pays les plus équitables du monde
En moins de deux décennies, l’Espagne est passée de deux jours de congé accordés aux pères à l’un des systèmes les plus étendus et équitables au monde. Cette évolution la place à la pointe de l’Europe.
La comparaison internationale révèle un panorama inégal. Tandis que l’Europe avance à des rythmes différents et que les États-Unis continuent de dépendre de législations fragmentées selon les États, l’Espagne a choisi un système universel et garanti. Le défi de la prochaine décennie sera de transformer ce droit en pratique quotidienne, de surmonter les barrières culturelles freinant encore de nombreux pères et d’encourager des politiques d’entreprise normalisant la conciliation.
Le congé parental n’est pas seulement un avantage professionnel. C’est un levier d’égalité et de bien-être. Le défi désormais est de le consolider pour que la coresponsabilité cesse d’être une aspiration et devienne une norme sociale et un moteur de prospérité partagée.
La version originale de cet article a été publiée dans la revue Telos, de la Fundación Telefónica.