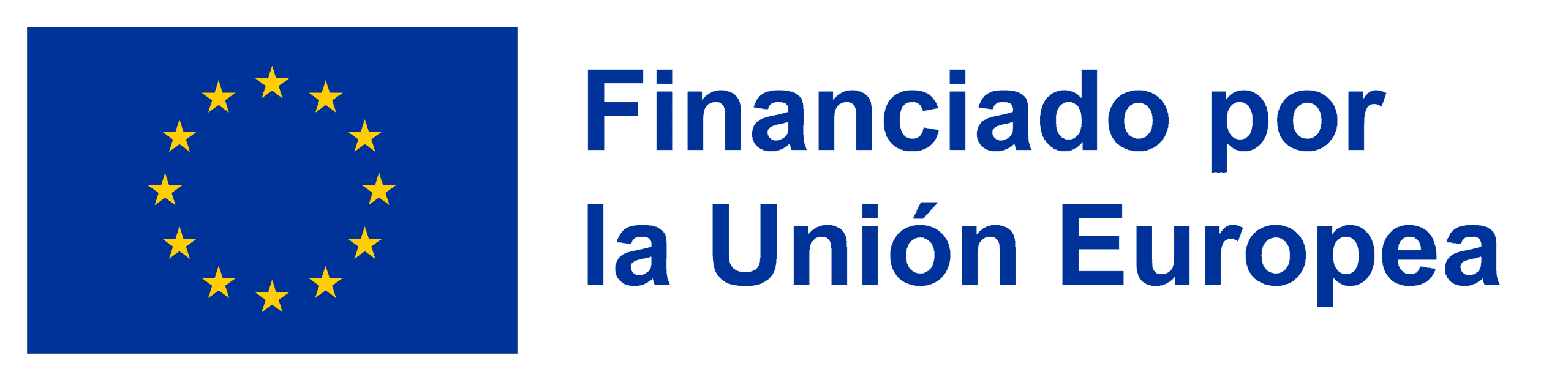Entre clichés touristiques, terrasses animées et ambiance de bars bondés, l’idée que « les Espagnols parlent fort » semble partout admise. Mais est-ce vraiment le cas ? Nous avons posé la question à Wendy Elvira-García, phonéticienne et professeure à l’Université de Barcelone. Verdict : la réalité est bien plus nuancée qu’il n’y paraît.
Il suffit d’un séjour en Espagne pour entendre cette remarque revenir en boucle : « Ils sont adorables, mais qu’est-ce qu’ils parlent fort ! » Dans les conversations de voyageurs comme dans les clichés médiatiques, le volume sonore de la parole espagnole semble presque devenu un trait culturel. Pourtant, derrière cette impression se cache une mécanique beaucoup plus complexe. Pour comprendre ce phénomène, Wendy Elvira-García, spécialiste de la production vocale, offre un éclairage qui bouscule bien des idées reçues. Ses explications replacent le » parler fort » espagnol dans un cadre plus scientifique… et surtout profondément social.
Ce n’est pas une question de langue
Oubliez l’idée que certaines langues seraient intrinsèquement plus bruyantes que d’autres. Selon Wendy Elvira-García, aucune étude scientifique n’a démontré que le volume de la voix varie selon la langue parlée. D’ailleurs, pour évaluer réellement l’intensité vocale, il faudrait utiliser un sonomètre, bien loin des simples impressions ou enregistrements.
L’espagnol n’est donc pas « fait » pour être parlé plus fort : ni ses consonnes, ni son rythme, ni son intonation n’entraînent un volume plus élevé. L’idée d’une prosodie castillane « énergique » est un mythe qui s’explique davantage par les contextes où on l’entend que par sa structure sonore.
Les vrais coupables : les lieux et l’ambiance
« Dans les endroits les plus bruyants, comme les bars, on finit toujours par parler plus fort. C’est aussi simple que ça. » Et c’est précisément là que naît le fameux malentendu sur le « volume » des Espagnols. Car où les entend-on le plus souvent ? Dans des bars bondés, sur des terrasses pleines à craquer, dans des restaurants familiaux où les grandes tablées s’entrecroisent en mille conversations simultanées. En Espagne, l’espace social est fréquemment plus animé, plus sonore, plus dense que dans beaucoup de pays voisins.
Face au bruit, tout le monde, espagnol ou non, augmente naturellement le ton pour se faire entendre. La phonéticienne Wendy Elvira-García le rappelle : ce phénomène n’a rien de spécifiquement espagnol « Au Royaume-Uni… dans les pubs, on parle très fort, surtout avec les matchs diffusés et les grands groupes. » Et c’est vrai : un pub anglais un soir de rencontre sportive n’a rien d’un salon de thé silencieux. À l’inverse, Paris cultive souvent une autre ambiance : petits cafés, minuscules tables pour deux, proximité feutrée… tout y invite davantage à la conversation basse.
Bref, plus que la supposée « voix espagnole », c’est surtout le bruit ambiant, la densité humaine et le type de lieu qui donnent cette impression de volume. Le décor, bien plus que les cordes vocales, fait toute la différence.
Un volume modulé selon le contexte
Contrairement aux idées reçues, les Espagnols ne parlent pas fort en permanence. Comme tout locuteur, ils adaptent naturellement leur voix au contexte. « À la maison, lorsqu’un enfant dort dans la pièce voisine, personne n’élève la voix. Lors d’une conversation en tête-à-tête, le ton se fait plus bas, presque discret. »
Ce que nous percevons souvent comme un trait culturel typique de l’Espagne n’est en réalité qu’une réaction contextuelle universelle. Simplement, les situations sociales les plus emblématiques du pays, fêtes, rassemblements, groupes nombreux, sont celles où le volume monte naturellement.
Un phénomène plus culturel que phonétique
Le volume peut bien sûr se mesurer : l’intensité sonore se calcule en décibels. Mais Wendy Elvira García rappelle que la perception est avant tout culturelle. « La perception dépend des espaces sociaux que l’on fréquente », souligne-t-elle. Si l’on vient d’un pays où les lieux publics sont plutôt calmes, les grandes tablées espagnoles peuvent sembler assourdissantes. À l’inverse, quelqu’un habitué aux pubs britanniques ou aux marchés méditerranéens n’y verra rien d’inhabituel.
Autrement dit, ce n’est pas l’Espagnol qui parle fort : c’est vous qui écoutez dans un cadre sonore différent du vôtre. Et comprendre cela change tout, transformant ce qui semblait un exubérant folklore sonore en une simple question de contexte et d’habitudes. Ce mythe, profondément ancré, en dit finalement plus long sur nos habitudes culturelles que sur la façon de parler des Espagnols. Et si, au fond, ce fameux « parler fort » n’était que le son chaleureux de la convivialité latine ?