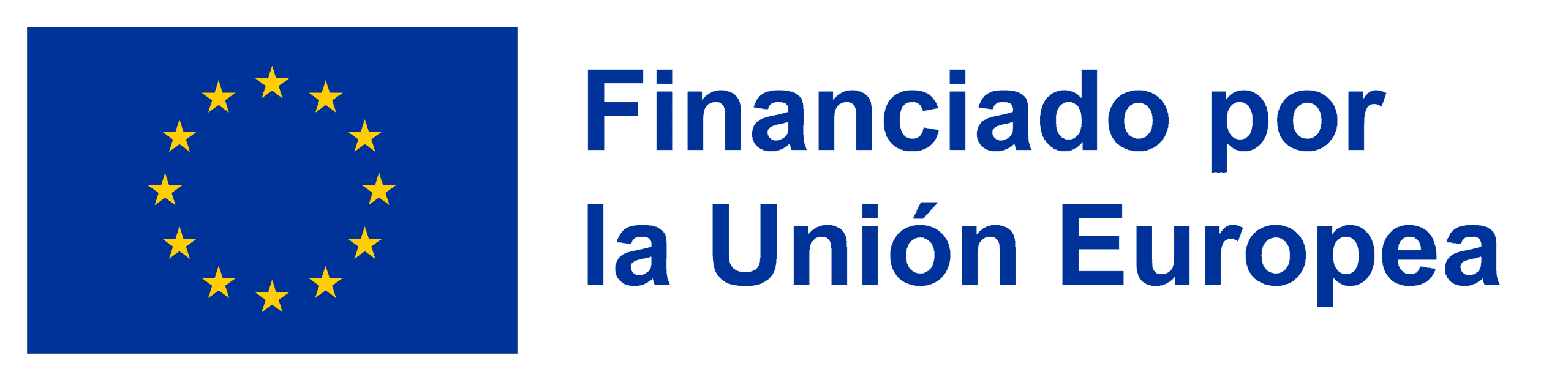À Barcelone, de nombreux expatriés peinent à se faire une place dans la société catalane, qu’ils jugent fermée et peu accessible. Derrière cette impression de froideur se cachent pourtant des codes culturels précis, et, surtout, un rapport très particulier à l’identité.
On les dit distants. Réservés. Peu enclins à la spontanéité. À Barcelone, nombre de nouveaux venus — expatriés curieux ou amoureux de la Méditerranée — se heurtent à un mur invisible dans le comportement des Catalans. Pas de rejet, non. Mais un rideau tiré. Une chaleur discrète, qui ne se donne pas. Qui se mérite… ou non.
Du côté des touristes, rien à signaler. La carte postale reste parfaite. « Nous venons souvent en Espagne et notamment à Barcelone, et nous sommes toujours très bien accueillis, c’est très chaleureux, que ce soit dans les hôtels, restaurants et boutiques », affirme Cathy, mère de trois enfants âgée de 42 ans et originaire de Toulouse. Depuis quinze ans, elle vient une à trois fois par an en Catalogne, et trouve les Catalans « très agréables ».
Mais ceux qui s’installent sur le long terme racontent autre chose. Une ville sublime, oui, mais une société refermée. « C’est une société compliquée, non ? J’ai l’impression que ce sont des gens très familiaux, qui restent toute leur vie avec les mêmes amis, dans leur bulle », raconte une Colombienne de 30 ans installée à Barcelone depuis trois ans, qui souhaite rester anonyme. « Même quand ils ont des relations toxiques entre eux, ils restent soudés, comme s’il y avait un manque à combler. Ils sont très possessifs avec leur cercle et fermés vis-à-vis des autres. Tout ça, peut-être à cause de l’histoire qu’ils ont vécue avec l’Espagne. »
Une possessivité avec « leur » Barcelone
Ce repli sur le noyau dur — famille, amis d’enfance, quartier — crée parfois une forme d’inertie sociale. « Même ceux qui voyagent reviennent toujours à leurs vieilles habitudes », poursuit-elle. Selon elle, ce fonctionnement limite l’ouverture vers d’autres cultures, voire alimente une forme d’auto-conviction collective : « Quand tu n’as pas beaucoup de références extérieures, tu crois que ta manière de faire est la meilleure. Tu n’as aucun moyen de comparer, alors tu t’auto-convaincs. »
La langue catalane, elle aussi, cristallise ce paradoxe : « Ils veulent que tu l’apprennes, mais en même temps, ils ne veulent pas te l’enseigner. Il n’y a pas beaucoup de moyens accessibles pour l’apprendre. C’est hyper étrange. » Cette contradiction, selon elle, reflète un mélange de jalousie, de protection et de frustration identitaire. « Ils ont tellement à partager — leurs restos, leurs références culturelles, des trucs qui pourraient plaire à tout le monde et même servir leur cause indépendantiste — mais ils gardent tout pour eux. »
D’autres expatriés partagent ce sentiment de « froideur ». « C’est la population la moins chaleureuse de la péninsule ibérique », affirme Mathieu, 24 ans, et présent à Barcelone depuis un peu plus d’un an. Une façon d’être qu’il ressent à la fois dans sa tentative de se faire des amis que dans la société en Catalogne. « J’ai l’impression que comme il y a une identité catalane, ils cherchent à la préserver coûte que coûte, quitte à être plus exclusifs dans leurs rapports sociaux », explique-t-il. « Du coup, c’est dur de se faire des amis catalans, même en parlant le catalan. C’est un sentiment unique que j’ai trouvé ici par rapport au reste de l’Espagne », déplore le jeune homme.
Une réserve identitaire
Ce ressenti est partagé avec de nombreux « expats » à Barcelone. Mais comment l’expliquer ? Pour le sociologue Salvador Cardús, professeur à l’Université autonome de Barcelone, la clé se trouve dans l’identité catalane. Une identité qu’il qualifie « d’épidermique » : elle se manifeste dans les symboles — langue, drapeau, traditions — mais reste très pudique dans la sphère intime. Le lien social ne se crée pas dans l’élan, mais dans le temps. Dans la fidélité.
Selon l’expert, ce repli apparent ne serait donc pas une marque de rejet pur, mais une forme de prudence émotionnelle. On ne s’ouvre pas à n’importe qui, ni n’importe quand. La chaleur existe, mais elle ne se donne pas à la première poignée de main : elle se construit. Reste que tout le monde ne semble pas disposé à faire cet effort.
L’universitaire Manuel Castells apporte une autre nuance. Né hors de la Catalogne mais profondément attaché à sa culture, il défend une vision inclusive de l’identité catalane. Selon lui, celle-ci repose sur le respect, la rationalité, la langue partagée — pas sur l’héritage ou l’origine. Autrement dit : on peut devenir Catalan. Mais il faut en comprendre les codes… et faire preuve de patience. Il part du principe que la Catalogne, comme toute société au fort sentiment identitaire, a aussi ses failles. Des blessures. Des tensions historiques entre les locaux et les « nouveaux venus » — qu’ils viennent du sud de l’Espagne ou d’autres coins du monde. Le terme de « charnego », jadis employé pour désigner de manière méprisante les immigrés venus d’Andalousie, résonne encore dans certaines mémoires. Aujourd’hui, ce sont les « guiris » qui ont pris le relais – un terme familier utilisé en Espagne pour désigner les étrangers, en particulier les touristes occidentaux, de façon plutôt péjorative.
Bref, si à Barcelone, la chaleur ne manque pas, elle ne se donne pas au premier venu. Il faut parfois insister, frapper plusieurs fois. Et surtout espérer que, de l’autre côté, quelqu’un soit prêt à entrouvrir la porte…