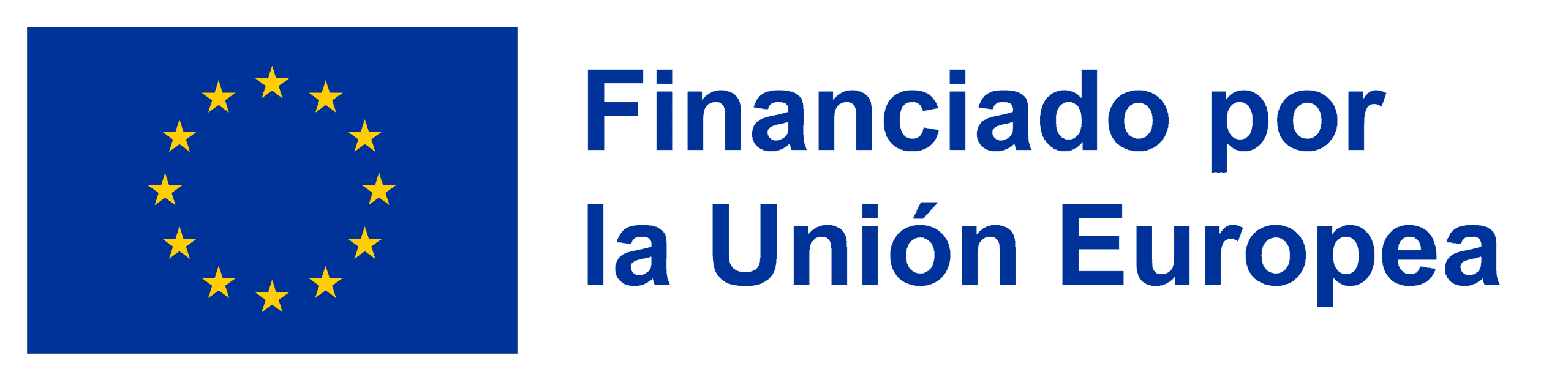Alors que la France continue de s’enliser dans un déficit structurel élevé, l’Espagne enchaîne les bonnes surprises budgétaires. Comment expliquer une telle divergence entre deux pays pourtant comparables ? Éclairage sur un modèle espagnol discret mais efficace.
Alors que Paris s’alarme d’un déficit public de 5,8 % du PIB – l’un des plus élevés de l’Union européenne – Madrid fait figure de bon élève inattendu. L’Espagne, autrefois dans la ligne de mire de Bruxelles, est désormais regardée comme un exemple de bonne gestion budgétaire. En 2024, son déficit est attendu à seulement 2,7 %, après avoir atteint 2,8 % l’année précédente, malgré des dépenses exceptionnelles liées aux inondations de Valence. Une performance saluée par les institutions financières, et soulignée par le journal The Economist, qui a récemment classé l’Espagne comme l’économie la plus performante de l’OCDE.
Cette réussite découle d’une stratégie patiente et disciplinée. Depuis la crise de 2008, l’Espagne a connu des années de turbulences : explosion du chômage, plans d’austérité et méfiance des marchés. Pourtant, le pays a su engager des réformes structurelles et rester sur une trajectoire de retour à l’équilibre. Contrairement à la France, où les alternances politiques ont souvent freiné la continuité des efforts budgétaires, l’Espagne a maintenu le cap, y compris dans un contexte de forte instabilité gouvernementale.
La réforme du marché du travail de 2021, pilotée par les socialistes, a porté ses fruits : amélioration du taux d’emploi, baisse du chômage chez les jeunes, et meilleure stabilité contractuelle. Du côté des retraites, une réforme a été votée sans grandes oppositions, repoussant l’âge de départ et augmentant la contribution des plus hauts revenus. Autant de décisions structurantes qui manquent encore cruellement en France.
Une croissance au-dessus de la moyenne européenne
Au-delà de la rigueur, la croissance espagnole joue un rôle déterminant. Portée par le tourisme, les exportations et les énergies renouvelables, l’économie espagnole avance à un rythme supérieur à celui de la zone euro. Les investissements étrangers affluent, attirés par une stratégie énergétique claire et une fiscalité stable.
Autre particularité espagnole : la maîtrise des dépenses publiques. Le gouvernement a réduit progressivement les mesures de soutien post-Covid, sans renoncer à la protection des ménages ni à l’investissement public. L’une des forces du modèle espagnol réside dans sa capacité à concilier discipline budgétaire et interventions ciblées : subventions à la transition énergétique, aides aux entreprises face à la crise énergétique, mais sans explosion de la dépense publique. Même le dernier budget, reconduit automatiquement en l’absence d’accord politique, est resté dans les clous.
Côté français, le constat est bien plus inquiétant. Endettement massif, manque de consensus politique sur les réformes, promesses non tenues de retour à l’équilibre. Le déficit français est plus proche de celui de la Roumanie que de ses partenaires historiques. Et les marchés commencent à s’en inquiéter : la dette française est désormais plus chère à financer que celle de l’Espagne ou du Portugal.