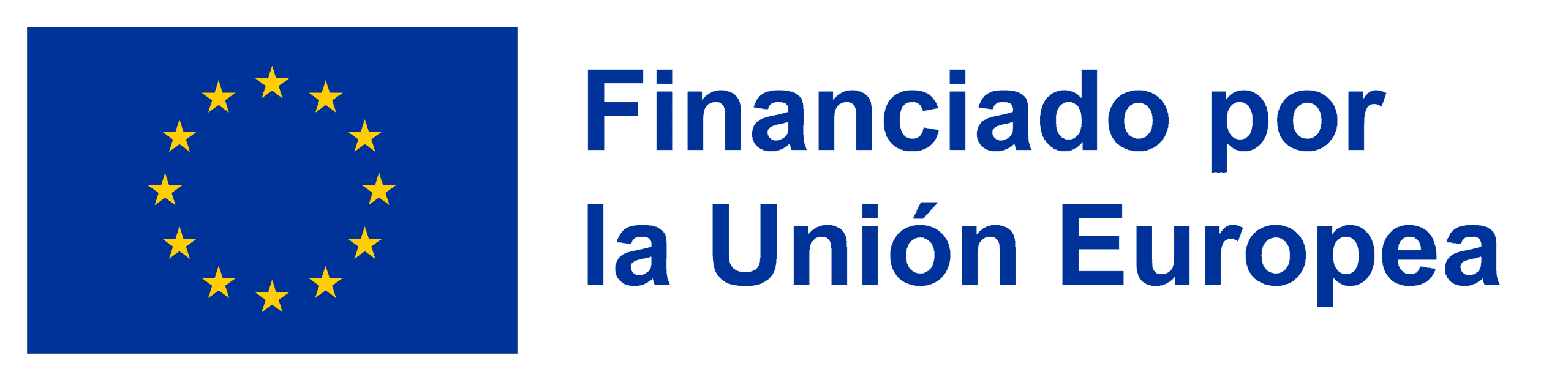Alors que l’Espagne s’apprête à commémorer le cinquantenaire de la mort du dictateur Francisco Franco, une vague de nostalgie semble s’emparer d’une partie de la jeunesse.
Par Maite Aurrekoetxea Casaus, Professeure docteure en sociologie à la Faculté des sciences sociales et humaines, Université de Deusto
Il y a quelques mois, nous avons vu devant le siège du PSOE à Madrid, rue Ferraz, des groupes de jeunes scandant « Franco, Franco » tout en agitant des drapeaux anticonstitutionnels. Peu de femmes, d’ailleurs. Et ils ne le faisaient pas comme une référence historique ni comme une provocation ironique : ils le faisaient sérieusement. Des jeunes nés plus de 25 ans après la mort du dictateur, revendiquant un passé qu’ils n’ont pas vécu et dont ils ignorent la dureté. Pourquoi ?
L’explication ne se trouve pas dans l’histoire, mais dans le présent. Cette nostalgie n’est pas spontanée : elle est induite. Le slogan « Sous Franco, on vivait mieux » agit comme un symptôme culturel d’un récit qui a gagné du terrain dans les sphères politique et médiatique : l’idée que la jeunesse actuelle a échoué, qu’elle « vit plus mal » que ses parents et que seul l’ordre du passé pourrait restaurer une supposée normalité.
Un récit qui n’est pas innocent
La phrase « les jeunes vivent plus mal » est devenue l’un des mantras les plus répétés par la droite et l’extrême droite européennes. Son efficacité ne tient pas à sa véracité, mais à sa charge émotionnelle : elle active la comparaison, le ressentiment, le sentiment de perte. Et, à partir de là, elle légitime le retour en arrière.
Ce discours ne décrit pas une réalité : il la construit. Car on parle de vivre plus mal, mais selon quels critères ? Moins de revenus ? Moins de liberté ? Une santé mentale dégradée ? Une plus grande difficulté à accéder au logement ? Chacune de ces dimensions comporte des nuances. Mais ce discours n’a pas besoin de complexité : il lui suffit d’une certitude simple et pessimiste pour justifier la nostalgie.
Idéaliser le passé revient à ignorer que de nombreuses générations antérieures ont travaillé dès l’âge de 14 ans, sans droits du travail, sans conciliation, sans accès à l’enseignement supérieur ni couverture santé. Il faut rappeler que la législation du travail antérieure à 1980 permettait des journées interminables, des salaires bas et une protection sociale limitée. La conciliation familiale n’existait pas, et l’accès à des droits tels que les congés payés, la formation continue ou les allocations chômage était réservé à certains secteurs privilégiés. Le passé n’a pas été une période de bien-être généralisé, mais une ère marquée par la précarité, les inégalités et de faibles perspectives d’amélioration.
Cette vie « meilleure » est en grande partie une invention rétrospective qui dépolitise les inégalités structurelles du présent. Et ce qu’il y a de singulier dans le slogan « Sous Franco, on vivait mieux », c’est qu’il évoque rarement la manière dont vivaient les femmes. La dictature n’a pas seulement imposé un modèle autoritaire sur le plan politique, elle a aussi aboli les droits conquis pendant la Seconde République et rétabli un régime juridique qui réduisait les femmes à l’obéissance et à la dépendance. En se mariant, les femmes perdaient leur capacité juridique : elles ne pouvaient pas gérer leurs biens, ouvrir un compte bancaire, ni même signer un contrat sans l’autorisation du mari.
Cette restriction était soutenue par la licence maritale, inscrite dans les articles 60 à 71 du Code civil de 1889, restée en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi 14/1975 du 2 mai. L’article 57 de ce même code stipulait littéralement que : « le mari doit protéger la femme et celle-ci doit obéissance au mari ». En outre, l’État a aboli le divorce (loi du 23 septembre 1939), supprimé le mariage civil (loi du 10 mars 1941) et restauré la patria potestas exclusive du père. Même en cas de séparation, la femme était « déposée » chez ses parents et pouvait être dépossédée du logement conjugal et de la garde de ses enfants. Si elle se remariait, elle pouvait perdre ses enfants, sauf autorisation expresse du mari décédé dans son testament.
Ce modèle n’a rien eu d’anecdotique : il fut la loi en Espagne jusque tard dans la Transition, façonnant toute une culture juridique de soumission féminine. C’est pourquoi l’idéalisation du passé franquiste comme une époque d’ordre et de prospérité ignore que cet ordre reposait sur la subordination légale de la moitié de la population. Est-ce vraiment ce modèle que ces jeunes souhaitent pour leurs compagnes, leurs sœurs ou leurs collègues ?
Le temps libre comme choix politique
En revenant à la réalité actuelle, comme le souligne le sociologue Chris Knoester dans une étude récente, ce qui est arrivé aux jeunes générations ces dernières décennies n’est pas une détérioration ni un déclin comparatif, mais tout le contraire : un changement profond dans la manière d’éduquer, de vivre ensemble et de concevoir le bien-être.
Il faut garder à l’esprit qu’aujourd’hui, les familles investissent davantage de temps et de ressources dans les loisirs organisés de leurs enfants, notamment le sport, comme expression d’un engagement émotionnel et d’un soutien global. Cette transformation, loin d’être un signe de faiblesse générationnelle, constitue une réussite intergénérationnelle.
Le temps libre, souvent dénigré par les discours conservateurs comme symbole de paresse ou d’évasion, est en réalité une autre manière de comprendre le bien-être. Les nouvelles générations valorisent la santé mentale, la qualité des relations et l’autonomie personnelle. Non pas parce qu’elles rejettent l’effort, mais parce qu’elles refusent de payer le prix d’une productivité excessive sans garanties d’avenir.
Selon l’Enquête sur les budgets familiaux de l’Institut national de la statistique (2024), en 2023, la dépense moyenne par foyer en Espagne s’élevait à 32 617 €, soit 3,8 % de plus que l’année précédente. Sur ce total, les ménages ont consacré 10,2 % à la restauration et à l’hôtellerie (soit 3 311 € par an), et 5,1 % aux loisirs et à la culture (1 651 € par foyer).
Loin d’être un comportement réservé aux classes aisées, l’augmentation des dépenses dans ces domaines traverse toutes les catégories de revenus. Chez les foyers les plus riches, les postes « loisirs, restauration et culture » représentaient jusqu’à 34,7 % du budget familial, contre 14 % dans les foyers les plus modestes. Appeler cela « vivre plus mal » relève d’une falsification intéressée. Et pourtant, cette falsification circule, se banalise, et se crie dans la rue comme une consigne politique.
Franco comme slogan efficace
Que des jeunes scandent « Franco, Franco » est le signe d’un manque de symboles alternatifs pour exprimer leur frustration. Dans ce vide, le récit réactionnaire offre un refuge. « Sous Franco, on vivait mieux » n’est pas de l’histoire : c’est une synthèse émotionnelle — ordre, hiérarchie, autorité, sécurité. Une traduction affective de la peur d’un présent dont la boussole est faussée.
Et cette peur est nourrie par des discours politiques qui répètent que tout va plus mal, que tout est brisé, que la faute revient au féminisme, à l’immigration ou à la diversité. Un discours qui ne cherche pas à comprendre le mal-être des jeunes, mais à s’en emparer pour le transformer en adhésion réactionnaire.
Il s’agit d’offrir une autre lecture : rappeler que le bien-être ne se mesure pas seulement à la propriété ou au salaire, mais aussi au temps libre, à la dignité, aux liens humains et à la santé. Il s’agit d’affirmer qu’il existe d’autres manières de bien vivre qui ne passent pas par l’imitation du passé.