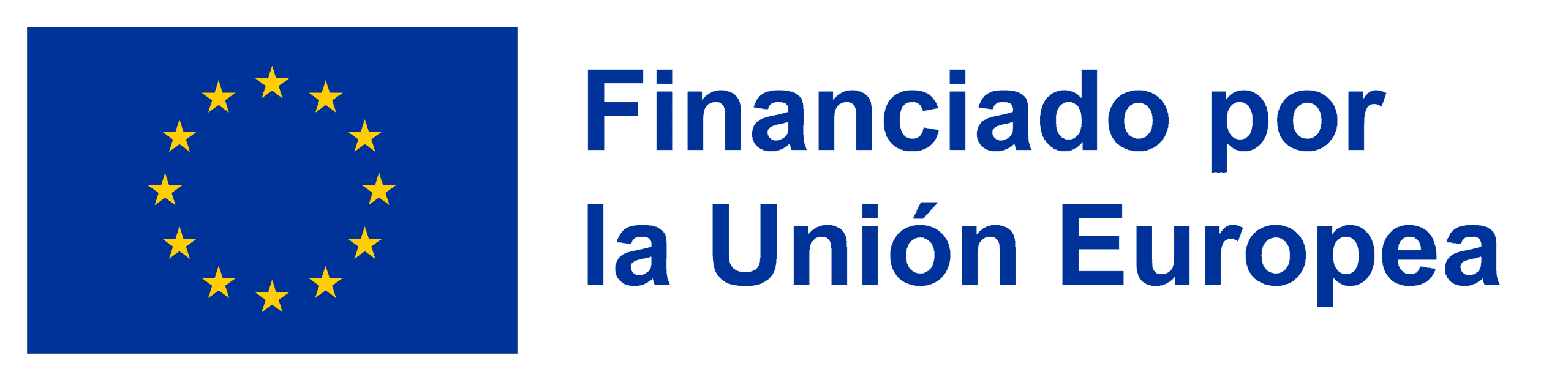Une des leçons les plus importantes que nous avons apprises en tant qu’ingénieurs au fil des années, c’est qu’il n’existe pas de systèmes parfaits ni infaillibles. Tout système, aussi sophistiqué soit-il, fonctionne dans les limites définies par ses spécifications. Lorsqu’il sort de ce cadre, son comportement peut devenir imprévisible.
Par Milan Prodanovic, chercheur senior et chef de l’Unité des Systèmes Électriques, IMDEA ÉNERGIE, et Javier Roldán Pérez, chercheur titulaire à l’Unité des Systèmes Électriques, IMDEA ÉNERGIE
Le 28 avril dernier, nous avons été témoins d’un événement inédit : la défaillance d’un système électrique entier, l’une des infrastructures les plus complexes et les plus coûteuses jamais construites par l’humanité. Ce type de système regroupe des milliers de professionnels de divers domaines — ingénierie, économie, opérations, maintenance, et bien d’autres — qui collaborent chaque jour pour que l’électricité circule de manière continue, invisible et silencieuse, depuis les centrales de production jusqu’aux millions de consommateurs.
Quelque chose a manifestement échappé aux prévisions, provoquant des conséquences de grande ampleur. Même si les hypothèses abondent actuellement, il faudra des jours, voire des semaines, pour comprendre avec certitude ce qui s’est passé. Pour tenter d’expliquer l’incident, il est utile de revoir comment fonctionne un système électrique moderne et comment il est maintenu en équilibre.
Un équilibre fondamental
D’un point de vue technique, le réseau électrique est conçu pour maintenir, à tout moment, un équilibre précis entre l’énergie produite et l’énergie consommée. Lorsque cet équilibre est rompu, même pour quelques millisecondes, des instabilités transitoires peuvent survenir. Si le déséquilibre se prolonge au-delà de quelques secondes, le risque d’un effondrement du système augmente considérablement.
Dans les systèmes à courant alternatif, la fréquence du signal électrique — 50 Hz en Europe — agit comme un indicateur clé de cet équilibre. Une fréquence supérieure à la valeur nominale indique un excès de production ; une fréquence inférieure, un déficit. C’est pourquoi les Codes Réseau établissent des marges strictes de tolérance, tant pour la fréquence que pour la tension.
Si un générateur ou une sous-station sort de ces marges, les systèmes de protection sont conçus pour les isoler automatiquement, afin d’éviter des effets indésirables ou imprévisibles. Lorsqu’on parle de « perte de production », on fait généralement référence à la déconnexion de générateurs déclenchée par ces protections, en raison de conditions anormales. C’est précisément ce qui s’est produit le 28 avril dernier, déclenchant une chaîne d’événements ayant conduit à la panne.
Comment maintenir la stabilité du réseau électrique ?
Historiquement, la stabilité du réseau électrique reposait sur ce qu’on appelle la “masse tournante” : l’inertie mécanique des grands générateurs synchrones connectés directement au réseau. Cette inertie agissait comme un amortisseur naturel face aux perturbations rapides, contribuant à maintenir une fréquence stable malgré les variations soudaines de la production ou de la demande.
Cependant, les sources renouvelables modernes, telles que le solaire photovoltaïque et l’éolien, ne disposent pas de cette capacité. Elles sont connectées au réseau par des convertisseurs électroniques de puissance, qui, par leur conception, ne réagissent pas automatiquement aux variations de fréquence et ne participent pas activement au contrôle de la tension, sauf si on les programme spécifiquement pour cela.
Outre sa dimension technique, le système électrique est un écosystème économique sophistiqué. Il fonctionne à travers différents marchés, principalement le marché de l’énergie (qui définit le mix de production horaire) et le marché des services d’ajustement (qui garantit l’équilibre en temps réel, même en cas de contingence).
Ces marchés visent à minimiser le coût global de l’énergie, mais l’intégration croissante des renouvelables — qui, une fois installées, produisent à coût marginal nul — augmente le besoin en services auxiliaires pour garantir la stabilité du système. En d’autres termes, ce que l’on gagne en efficacité économique peut exiger davantage d’investissements pour assurer la fiabilité opérationnelle.
Quand les renouvelables deviennent majoritaires
Le mois d’avril, marqué par une faible demande électrique (ni chauffage ni climatisation intensifs), est idéal pour que les renouvelables couvrent une grande partie de la consommation. Cela réduit le coût de production, mais implique aussi de faire fonctionner le réseau dans des conditions de faible inertie, avec moins de générateurs rotatifs et plus de convertisseurs électroniques. Tout indique que l’incident du 28 avril s’est produit dans ces conditions, qui ont sans aucun doute contribué à la défaillance.
Heureusement, les convertisseurs modernes peuvent déjà être contrôlés pour imiter le comportement de la production rotative, offrant un soutien inertiel et aidant à stabiliser fréquence et tension.
Les chercheurs de l’Unité des Systèmes Électriques d’IMDEA Energía travaillent au développement de nouveaux algorithmes de contrôle pour les convertisseurs de puissance, qui servent d’interfaces pour les sources renouvelables et les batteries. Pour que cela devienne une réalité généralisée, il faut des changements réglementaires, des incitations économiques et de nouveaux mécanismes de rémunération valorisant ces services.
Dans des pays comme l’Espagne, qui exploitent des réseaux relativement isolés, des marchés spécifiques pour les services de stabilité — comme l’inertie réelle ou virtuelle — sont déjà en cours de création, et les exigences de raccordement sont en cours de révision pour permettre une participation active des renouvelables au contrôle du système.
Du point de vue d’un ingénieur, il est clair que pour garantir la fiabilité des systèmes électriques dans des conditions d’exploitation de plus en plus exigeantes, nous devons repenser les principes traditionnels de fonctionnement. Il ne s’agit pas seulement de s’adapter, mais de définir de nouvelles spécifications pour un système, un produit vital, en évolution rapide, dont nous dépendons tous.
Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Lire la version originale.