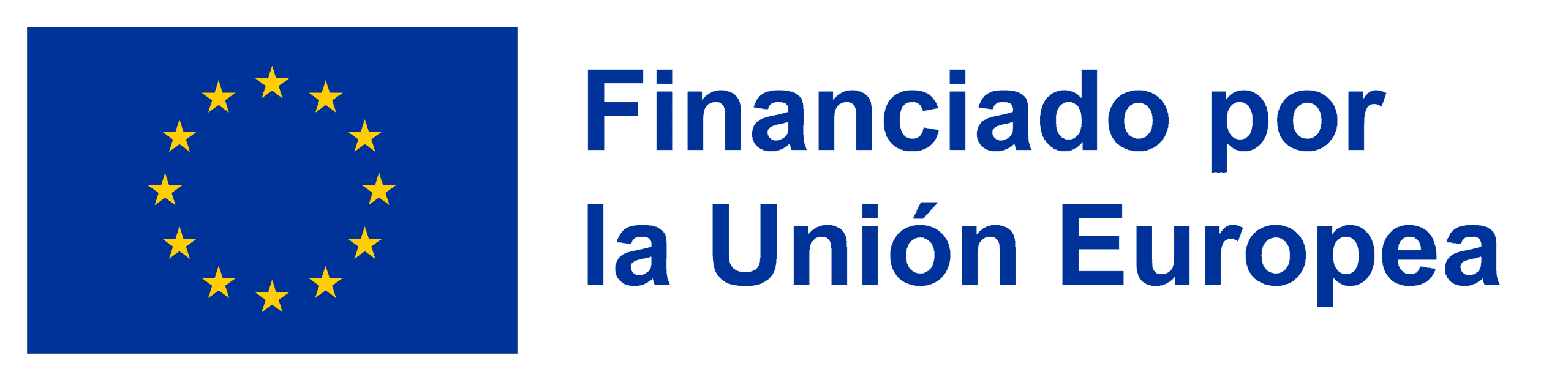Retour sur l’influence des Lumières et de la Révolution française au-delà des Pyrénées : un moment d’histoire déterminant pour la Catalogne.
Le slogan « Liberté, égalité, fraternité ! », crié à Barcelone en juillet 1789 par un artisan forgeron lors d’une foire locale, provoqua la stupeur des soldats de l’armée monarchique espagnole et le sourire des bourgeois éclairés.
Au nord des Pyrénées, le Roussillon, ancien territoire catalan rattaché à la France, est intégré au royaume de Louis XVI. Mais les liens, notamment linguistiques et culturels, persistent avec Barcelone. Durant les journées révolutionnaires, la ville de Perpignan est en ébullition. Fin juillet 1789, le petit peuple se soulève, s’empare des bureaux fiscaux et brûle les archives des créances royales, rendant impossible le recouvrement des impôts. Des émeutes antifiscales éclatent aussi à Prades et dans d’autres localités. La chaleur révolutionnaire traverse les Pyrénées.
Deux années de tolérance
À Barcelone, l’enthousiasme pour les idées de 1789 reste d’abord cantonné aux milieux urbains alphabétisés ; la dévote paysannerie y voit surtout une menace antireligieuse. Le pouvoir en place, le monarque bourbonien Charles IV, tolère jusqu’en 1791 les débats autour des idées révolutionnaires. La principale motivation de Madrid demeure le commerce avec la France prospère, et la cour refuse de rompre les échanges. Durant ces deux années, les principes révolutionnaires diffusent ainsi en Catalogne. Le 5 mai 1789, la première édition en espagnol de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est imprimée à Barcelone et, quelques mois plus tard, la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, creuset des idées des Lumières, est fondée.
La décapitation de Louis XVI à Paris change durablement l’atmosphère et met fin à la tolérance espagnole, d’autant que l’abolition définitive des privilèges ecclésiastiques alarme le clergé. Charles IV rejoint la Première Coalition antifrançaise en 1793, aux côtés des Autrichiens partis au secours de Marie-Antoinette. Désormais, Madrid craint la propagation des idées révolutionnaires et redoute tout particulièrement la diffusion de la propagande jacobine en Catalogne et dans le nord de l’Espagne, d’autant qu’une conspiration républicaine y est découverte en 1795.
Sur le terrain, la guerre du Roussillon éclate. Les hostilités se déroulent de part et d’autre des Pyrénées. L’armée espagnole envahit d’abord le Roussillon et atteint Perpignan, profitant de la confusion qui règne alors en France. Par un renversement d’alliance après 1795, l’Espagne dirigée par Godoy s’allie finalement à la France révolutionnaire. L’influence française devient alors paradoxale : l’Espagne demeure une monarchie absolutiste qui censure les idées libérales.
Ruine économique et éveil culturel
En Catalogne, les événements révolutionnaires marquent profondément la région et laissent un héritage ambigu. Sur le plan social, la Catalogne sort démographiquement et économiquement dévastée des guerres révolutionnaires. Les sièges, batailles, épidémies et famines ont fauché des dizaines de milliers de vies. L’économie catalane, en plein essor au XVIIIᵉ siècle — notamment dans des villes comme Barcelone ou Mataró — subit un coup d’arrêt brutal. Le commerce maritime est ruiné par le blocus britannique, puis par l’occupation française, et les échanges avec l’Amérique sont coupés.
Parallèlement, un réveil culturel catalan se dessine à partir des années 1830-1840 : c’est la Renaixença, ou Renaissance catalane. Des poètes et érudits comme Carles Aribau ou Jacint Verdaguer redécouvrent la langue catalane et son glorieux héritage médiéval. Ce mouvement, encore apolitique, est encouragé par le romantisme européen. La France post-révolutionnaire joue ici un rôle significatif grâce aux liens tissés entre les milieux catalans, occitans et provençaux, sans compter l’attrait du centre culturel parisien qui séduit artistes et écrivains catalans.
C’est dans ce laboratoire que naît progressivement le nationalisme catalan moderne. Vers 1850, il n’existe pas encore de mouvement politique catalaniste structuré, mais les bases en sont posées : une bourgeoisie consciente de ses intérêts économiques, frustrée par le centralisme madrilène, et une élite intellectuelle qui valorise la langue et l’histoire de la Catalogne. Les idées de nation et de droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, issues en partie de la Révolution française et des mouvements de 1848, commencent alors à infuser.
Ironiquement, la Révolution française influence la Catalogne de deux manières opposées : d’un côté, elle incarne longtemps l’ennemi — le jacobin centralisateur et antireligieux honni des Catalans ; de l’autre, elle offre le modèle d’une révolution bourgeoise réussie qui fascine les libéraux.
La Catalogne admire désormais la République française. Nombre de familles bourgeoises envoient leurs enfants étudier à Paris ou à Toulouse ; ingénieurs, médecins et artistes catalans s’inspirent des innovations venues de France. Paris est perçue comme la capitale de la modernité et de la liberté intellectuelle, contrastant avec Madrid, jugée bureaucratique et rétrograde. Le mouvement catalaniste envisagera même d’adhérer à l’Organisation internationale de la Francophonie, arguant de la parenté linguistique et des affinités culturelles historiques avec la France.