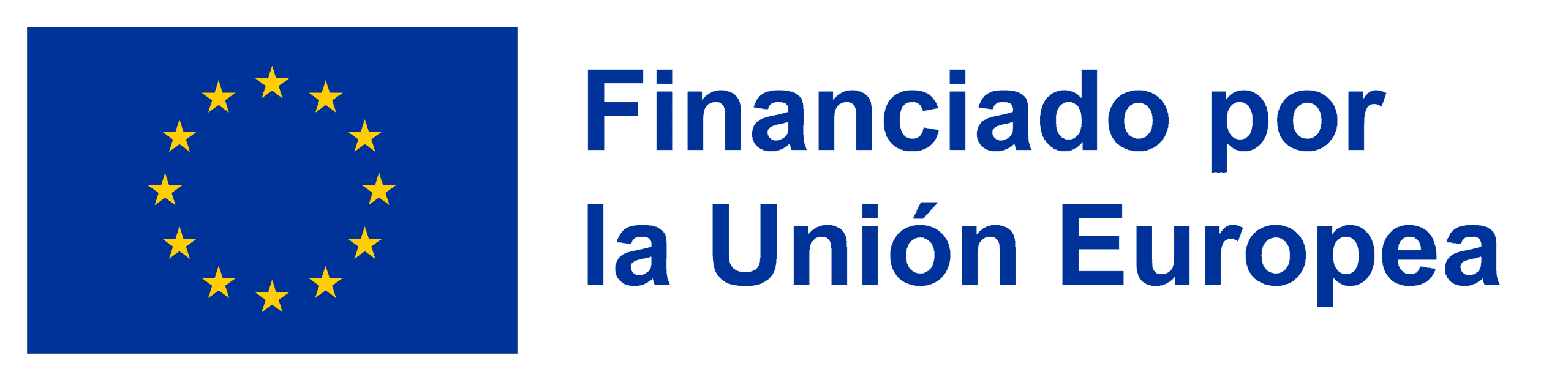Vivre en Espagne transforme le quotidien. Nouvelles langues, nouveaux codes sociaux, nouveaux repères : même si, pour les Français, la proximité avec Barcelone facilite la transition, le cerveau tourne à plein régime. Entre stimulation cognitive et sentiment de solitude, l’expatriation bouscule nos circuits comme nos émotions. Que se passe-t-il vraiment dans nos têtes lorsque l’on s’installe à l’étranger ?
Photos : Clementine Laurent
Comprendre l’espagnol au travail, se familiariser avec le catalan dans la rue, prendre le rythme des repas à 14h, s’habituer à une plus grande proximité sociale. Arrivée il y a un an et demi, Charlotte, 24 ans, se souvient de ses premiers jours à Barcelone. : « au début, c’était très fatiguant… mais j’ai plutôt apprécié ce côté-là, c’était assez challengeant », confie la jeune fille, arrivée pour un stage, puis embauchée dans une entreprise de cosmétique.
Comme pour beaucoup de nouveaux arrivants à Barcelone où cohabitent catalan et castillan, ces changements demandent un effort cognitif intense. Thomas*, 27 ans, vit à Barcelone depuis deux ans, où il a installé son cabinet d’ostéopathe. Pour lui, les premières semaines ont surtout été un tourbillon : découverte de la culture locale, rencontres faciles, sensation de redémarrer à zéro.
Un shoot de nouveauté stimulant et énergivore
Cette phase d’euphorie n’a rien d’anodin. « L’arrivée active la libération de dopamine, générant un sentiment d’excitation et de motivation propre à la découverte », explique la neuropsychologue Sarah Joanne. Le cerveau réagit comme face à un grand projet : curieux, mais débordé, il fait face à de nombreux défis cognitifs et émotionnels. Beaucoup d’automatismes qui facilitent le traitement de multiples informations quotidiennes sont absents. « Cette stimulation constante peut aussi créer une surcharge sensorielle et émotionnelle, le temps que le cerveau trouve un nouvel équilibre », poursuit-elle.
L’apprentissage d’une nouvelle langue sollicite fortement cette plasticité. Chaque phrase demande un effort : il faut inhiber le français pour activer l’espagnol ou le catalan, un mécanisme bien documenté en neurosciences. « Je pensais qu’en quelques mois je parlerais très bien. En réalité, ça m’a demandé plus d’efforts que prévu, et même après deux ans, je ne suis pas encore au niveau que j’espérais », raconte Thomas, pour qui la précision du langage est essentielle dans les consultations.
A long terme, cette gymnastique est bénéfique. Selon France Alzheimer, le bilinguisme stimule mémoire et attention, augmente la matière grise dans certaines régions cérébrales et pourrait réduire le risque de développer des maladies neurodégénératives. Chaque habitude remplacée est une route neuronale à recréer. Les fonctions cognitives sociales, comme comprendre l’autre, identifier les nuances culturelles, et anticiper les réactions des autres, sont aussi très sollicitées.
Le cerveau social mis à l’épreuve
Ce qui devient encore plus vrai dans une ville comme Barcelone, dynamique, attirante, mais aussi une ville de passage. Ce mouvement constant complique la création de relations stables. « Le plus dur, c’était de créer des liens forts, et surtout sur le long terme. Personne ne reste longtemps », raconte Charlotte, qui a vu tous ses amis partir à la fin de son stage. Comme elle, beaucoup affrontent une forme de solitude, où le turn-over permanent influence le bien-être psychique.
La neuropsychologue Sarah Joanne le constate : « Au fil du temps, cela crée une forme de frustration, de lassitude face à des liens souvent éphémères et superficiels ». Ce manque de stabilité relationnelle peut amener à un sentiment d’isolement, même chez ceux qui, comme Charlotte, mènent une vie active et entourée : « sans mon cocon familial ou mes amis d’enfance, je me sentais parfois un peu en décalage ».
Identité : mieux se percevoir, se redéfinir
Paradoxalement, cette situation ouvre aussi une porte inattendue : l’introspection. En sortant de sa zone de confort, Charlotte explique avoir appris à être seule, à mieux se connaître, à décider pour elle-même. Une étude internationale confirme ce phénomène : vivre à l’étranger renforce la perception de soi, et favorise une plus grande clarté dans les choix de carrière. « Sur le plan cognitif, le cerveau de l’expatrié mobilise particulièrement ses fonctions exécutives, ces mécanismes qui jouent le rôle de chef d’orchestre pour réguler nos pensées, nos actions et nos émotions » explique Sarah Joanne.
Cette flexibilité mentale stimule leur créativité en bousculant leurs repères. Ils se retrouvent souvent amenés à se réinventer, dans leur vie personnelle comme professionnelle, et à imaginer des projets dans leur pays d’accueil.
Un effet globalement positif sur le cerveau
Si l’expatriation peut bousculer, elle stimule aussi fortement le cerveau… à condition d’évoluer dans un environnement relativement sûr et stable. Dans un contexte comme celui d’un départ de la France vers l’Espagne, le cerveau dispose de l’espace nécessaire pour s’adapter, créer de nouvelles connexions, renforcer sa flexibilité et affiner sa régulation émotionnelle. Avec quelques repères, des communautés où s’ancrer et une préparation minimale, cette transition reste donc un excellent exercice pour le cerveau.
« Cela change notre rapport au monde, et donc à nous-mêmes », résume la neuropsychologue Sarah Joanne. Chez Charlotte, c’est devenu de la confiance. Pour Thomas, un sentiment d’avoir changé sa façon de penser. Une expérience qui nourrit l’esprit, ouvre les horizons, et renforce la capacité à se réinventer.
*Identité modifiée pour les besoins de l’article
Notre grand dossier : Comment apprendre l'espagnol et le catalan en même temps? 5 conseils pour apprendre l'espagnol à Barcelone Les thérapeutes français à Barcelone Nouveaux arrivants : les réseaux français à Barcelone