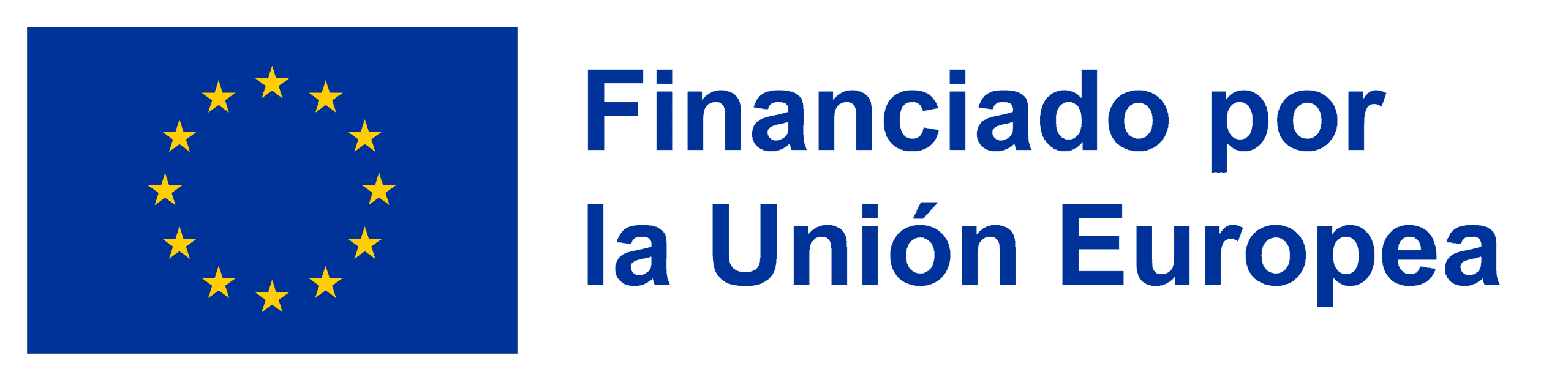Quand on pense cloche, on pense bossu de Notre-Dame et 15e siècle. Pourtant, en Espagne, les cloches sont de plus en plus modernes et les jeunes semblent y trouver une manière de perpétuer leur patrimoine. Une passion qui n’est pas du goût de tous.
Photo : Equinox
Qui a dit que sonner la cloche était ringard ? En Espagne, loin d’être une affaire de vieux nostalgiques, cette tradition ancestrale et tonitruante attire la jeunesse. Inscrite depuis 2022 au Patrimoine mondial de l’Unesco, la sonnerie manuelle de cloches espagnole est une technique bien ancrée et fièrement revendiquée. Car contrairement à la France, où les clochers ont tous été électrifiés de longue date, en Espagne, on continue – dans certaines églises – à frapper les cloches à la main. Mieux : ici, on monte dans le clocher, on s’approche de l’instrument, on le fait résonner au corps-à-corps.
Ce tour de main espagnol est « une spécificité culturelle », nous explique Francesc Llop i Bayo, président de l’association des cloches valenciennes et docteur en anthropologie. Et une spécificité qui attire les nouvelles générations, de plus en plus désireuses d’aider à la sauvegarde de leur patrimoine. Tant est si bien qu’un nombre croissant d’églises retirent les moteurs de leurs clochers pour permettre une sonnerie manuelle.
C’est par exemple ce qu’il s’est passé à la basilique Santa Maria de Mataró en Catalogne, qui a restauré ses cloches l’année dernière. Et depuis quelques mois, c’est Francesc lui-même qui donne des cours pour apprendre « à des jeunes, et pas forcément des croyants » ce métier ancestral.
Ici comme ailleurs dans le pays, les jeunes veulent donc en être. Et ce regain d’intérêt est visible sur Instagram, où certains passionnés à peine adultes partagent leur hobby de carillonneurs en diffusant des vidéos sur le sujet. C’est le cas d’Ulises Hernando Chico, de Burgos, qui se décrit comme « investigateur musical et divulgateur de patrimoine ».
Ver esta publicación en Instagram
Pour notre « clochologue » Francesc Llop i Bayo, rien de plus normal. La fête populaire, dont les cloches sont une des expressions, est revenue à la mode, et la jeunesse a suivi. Il cite en premier lieu les fiestas mayores, ces fêtes de villages ou de quartiers – que l’on connait bien à Barcelone – et qui avaient perdu de leur popularité jusqu’à leur renaissance il y a 60 ans. Aujourd’hui, les décorations, le comité d’organisation et les danseurs traditionnels sont tous de la génération Z : une preuve que les moins de 30 ans sont présents lors d’événements folkloriques régionaux.
L’anthropologue note tout de même une différence avec les siècles précédents : désormais les sonneurs de cloches, danseurs de castellers ou géants ne sont pas payés, ou en tout cas pas comme on l’entend. « On a retrouvé le sens de la fête. Sonner les cloches est devenu un acte de patrimoine, donc un acte volontaire. C’est un privilège, désormais, d’accéder à la salle des cloches pour voir ces instruments du 15e siècle. Alors on n’est plus payés économiquement mais moralement. » raconte le septuagénaire.
La guerre du bruit
Un acte de patrimoine, certes, mais qui génère un bruit pas du goût de tout le monde. Car si la pratique est désormais reconnue par l’Unesco, les cloches elles-mêmes ne bénéficient pas toujours d’un cadre de protection juridique. En Espagne, la gestion du patrimoine relève des communautés autonomes : si à Valence elles sont classées comme exception patrimoniale et donc intouchables, ce n’est pas le cas partout sur le territoire.
Une disparité flagrante qui a conduit, le 28 mars 2017, à la condamnation de la paroisse de Hinojosa del Campo (Castille-et-Léon) par la cour provinciale de Soria. Sur ordre juridique, l’édifice religieux a du « désactiver » la cloche de son église et verser 2 000 euros à un voisin, excédé par les sonneries répétées. Doit-on pour autant s’inquiéter de l’avenir des cloches, et cette détestation a-t-elle à voir avec un rejet de la religion ?
Pas vraiment, répond Francesc. Pour lui, les plaintes de certains habitants ne traduisent pas une baisse de la foi, mais plutôt un éloignement du collectif. D’ailleurs, pour lui, « le bruit n’existe pas. Le bruit est le son produit par un membre externe de ma communauté. Si je mets ma machine à laver, ce n’est pas un bruit pour moi mais pour les autres… Donc ceux qui se plaignent des cloches, c’est simplement l’expression de rejet d’un groupe qui ne se sent pas dans une communauté : ça n’a rien à voir avec la religion chrétienne. Par ailleurs, il y a toujours eu des gens qui se plaignent des cloches. »